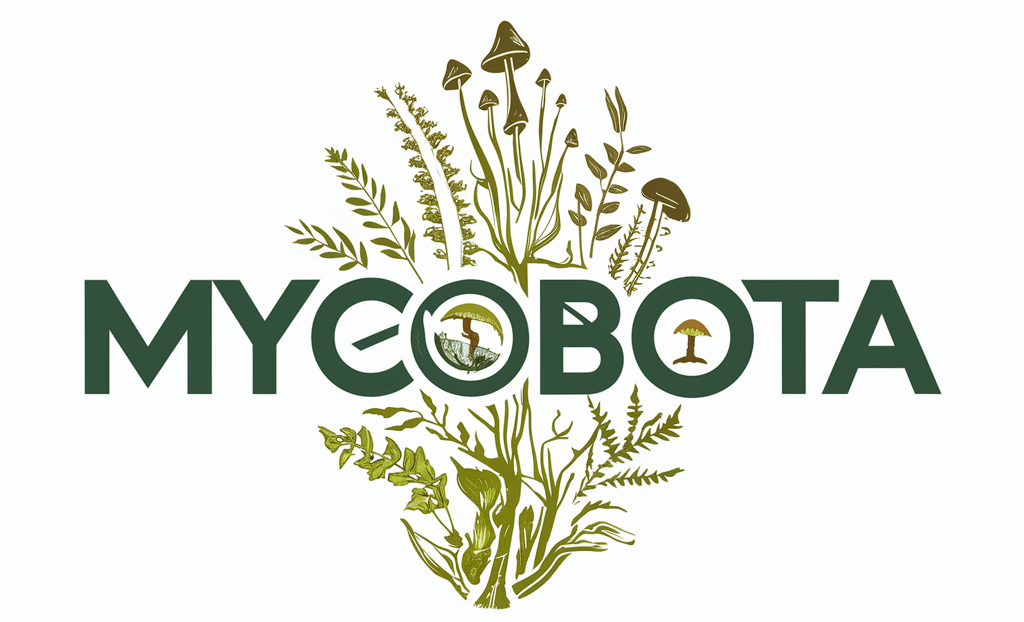Lepiota castanea – lépiote châtain
La lépiote châtain est une petite espèce toxique relativement commune, surtout sous les feuillus, en bordure de chemin, ou même dans les parcs et jardins.
Attention à ne pas consommer ce genre de champignon.
Vous pouvez parfois le croiser en sortie mycologique.
Fiche d’identité mycologique
- Famille : Agaricacées (les lépiotes).
- Nom latin : Lepiota castanea.
- Nom français : Lépiote châtain, lépiote marron.
- Habitat : Bords de chemins forestiers, talus herbeux forestiers, parcs et jardins. Sous feuillus ou taillis. Apprécie les sols riches en humus.
- Répartition : Assez commun, en plaine principalement.
- Période de fructification : De septembre à novembre.
- Taille : Environ 4 à 6 cm de hauteur, chapeau de 3 à 5 cm de diamètre.
Descriptif du champignon
La lépiote châtain (Lepiota castanea), parfois appelée lépiote marron, est une espèce de champignon basidiomycète de la famille des Agaricaceae. Ce champignon, moins commun que d’autres lépiotes, est surtout connu pour sa toxicité mortelle due à la présence d’amatoxines.
Le chapeau est d’abord globuleux puis campanulé à étalé. Il atteint 2 à 4 cm de diamètre. Sa surface se caractérise par des squames concentriques brun châtain à brun rougeâtre, plus denses au centre, sur un fond blanchâtre. Les marges restent souvent pâles et légèrement striées avec l’âge.
Les lamelles sont libres, serrées et blanches à crème, elles présentent parfois des teintes rosées à maturité. Leur arête peut être finement denticulée.
Le pied est cylindrique et creux, mesurant 3 à 6 cm de hauteur pour 0,3 à 0,6 cm d’épaisseur. Il est recouvert de fibrilles brunâtres, surtout à la base, et porte un anneau membraneux fragile, souvent fugace, laissant parfois des traces en zone annulaire.
Ce champignon possède une chair mince et blanche, immuable à la coupe. Son odeur est décrite comme indistincte ou légèrement fruitée, contrastant avec les effluves marquées d’autres lépiotes.
Ses vertus médicinales
- En usage interne ou externe : La lépiote châtain étant très toxique, elle n’est pas employée à titre médicinal.
Sa toxicité
La présence d’amatoxines la rend mortellement vénéneuse : sa consommation provoque des syndromes phalloïdiens sévères.