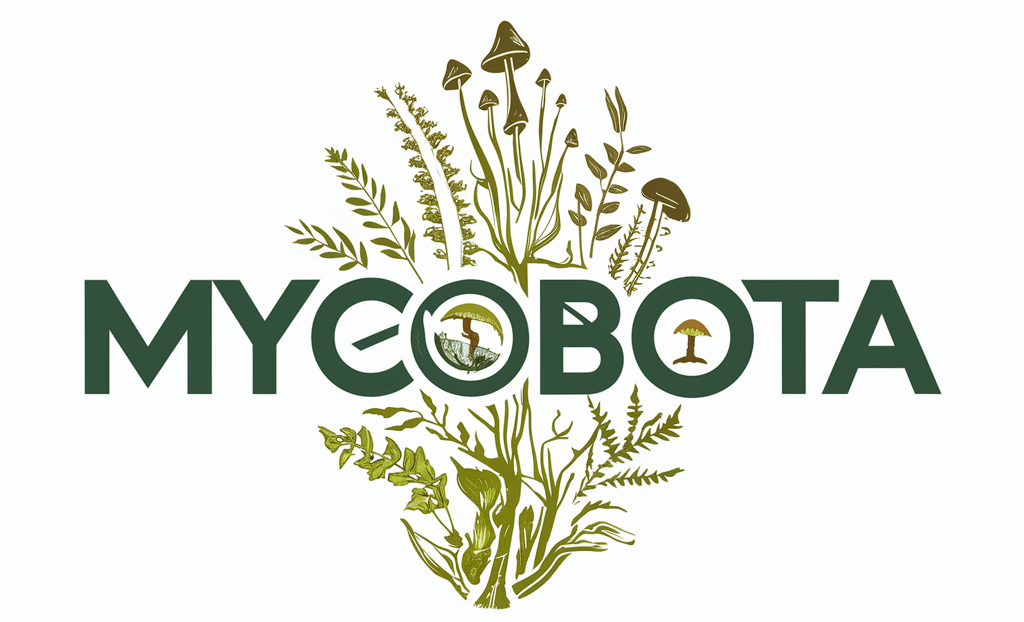Cortinarius speciosissimus – cortinaire très joli
Le cortinaire très joli est également l’un des cortinaires les plus toxiques, responsable du syndrome orellanien. Ce champignon reste relativement rare en France.
En cas d’intoxication avec ce champignon, contactez immédiatement un centre antipoison.
Fiche d’identité mycologique
- Famille : Cortinariacées
- Nom latin : Cortinarius speciosissimus, Cortinarius rubellus.
- Nom français : Cortinaire très joli.
- Habitat : Forêts de résineux, assez rarement de feuillus, ou dans les bois mêlés résineux et feuillus, généralement sur sol moussu.
- Répartition : Assez rare. Surtout en moyenne montagne.
- Période de fructification : Octobre et novembre.
- Taille : Chapeau de 4 à 7 cm de diamètre, pied de 6 à 8 cm de hauteur.
Description du champignon
Le cortinaire très joli (Cortinarius speciosissimus = Cortinarius rubellus) est une espèce de taille moyenne, au pied cylindrique et sans bulbe à la base. Sa chair, douce et de couleur jaune paille tirant sur l’orangé, dégage une odeur caractéristique de rave. Le chapeau, d’abord mamelonné et bombé, s’étale à maturité. Sa cuticule est généralement orange-brun, parfois avec des nuances rouge-brun, non visqueuse même par temps humide, et présente une texture vaguement duveteuse et fibrilleuse.
Les lamelles sont de couleur brun-orange. Le pied, également brun-orange pâle et assez épais, porte une cortine pâle, parfois plus ou moins effacée.
Ses vertus médicinales
- Indications : Cette espèce très toxique n’est pas employée au plan médicinal.
Sa toxicité
Ce champignon est potentiellement mortel, provoquant le syndrome orellanien, également observé avec le cortinaire des montagnes (Cortinarius orellanus). Après une longue période d’incubation, parfois de plusieurs jours, les symptômes commencent par une polyurie et une soif intense, suivis d’une destruction des tissus rénaux, conduisant à une insuffisance rénale apparemment irréversible. Cette insuffisance peut entraîner le coma, puis la mort.
Dès 1972, des cas d’intoxications mortelles ont été observés en Scandinavie à la suite de la consommation de ce champignon, comme le rapporte une
étude publiée dans le Lancet.